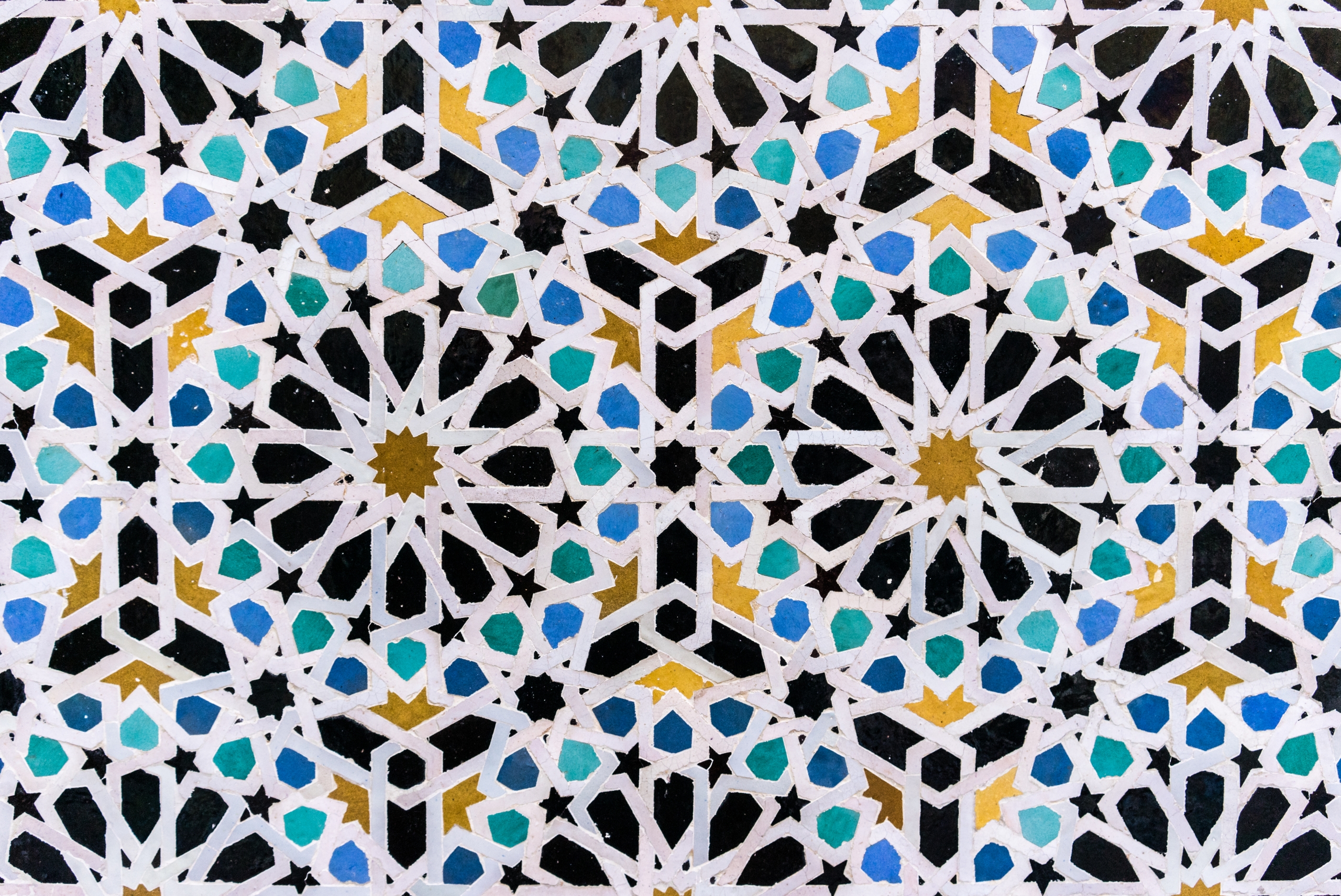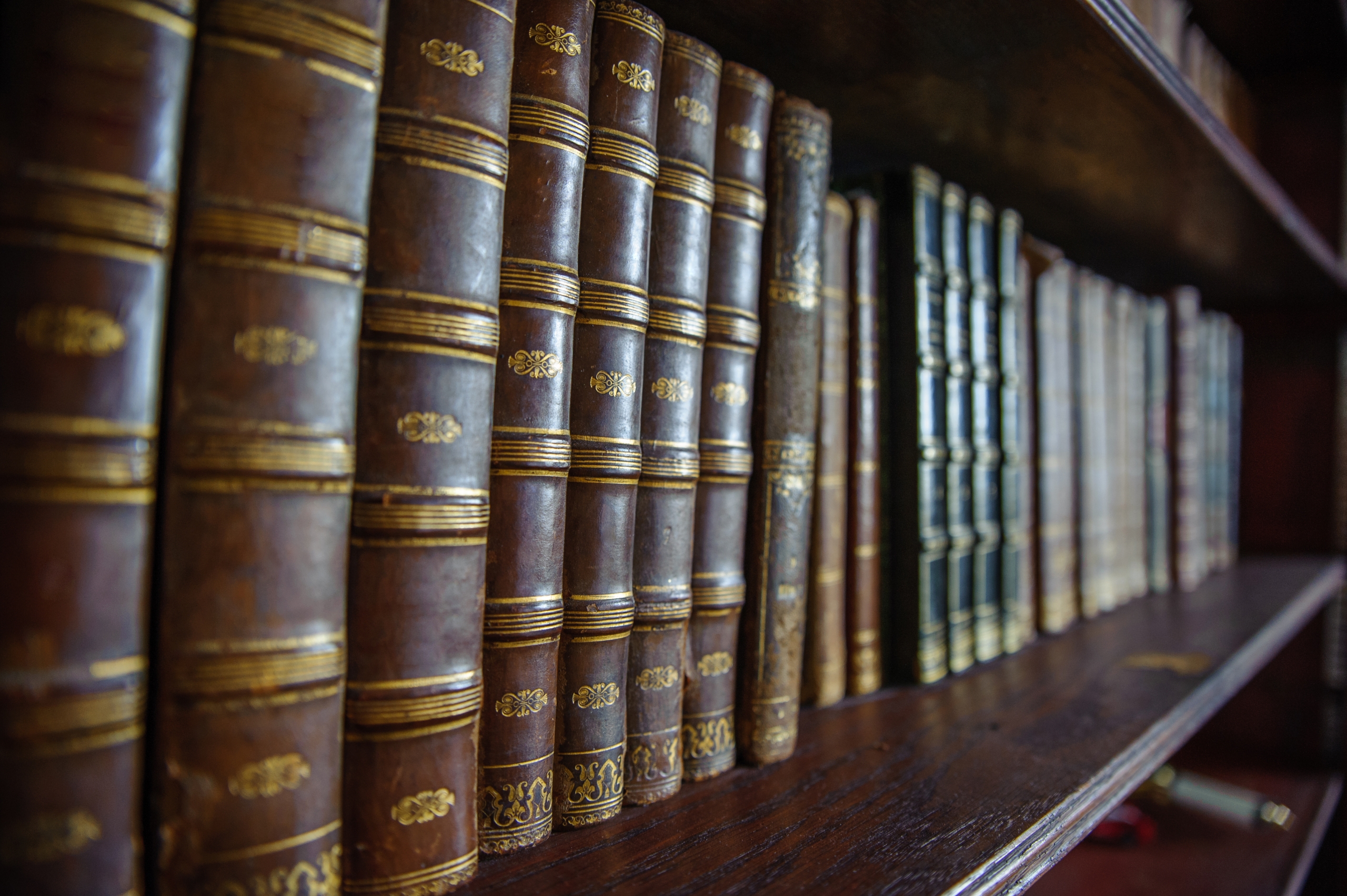Les communautés musulmanes au Tessin entre diversité, invisibilité et participation sociale

Dans la perspective d’un renforcement de la cohésion sociale, une responsabilité partagée des institutions et de la société civile, il est essentiel de disposer d’informations factuelles et de connaissances scientifiques sur la diversité religieuse et culturelle locale. Dans le contexte tessinois, une contribution déterminante à la compréhension de cette thématique est la recherche « Re:Spiri. Cartographie de la diversité religieuse et spirituelle du canton du Tessin », promue par le Département des institutions du canton et réalisée par le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC). L’étude a analysé les caractéristiques des communautés religieuses, mettant en évidence l’importante diversité entre les traditions présentes au Tessin et au sein de celles-ci. La recherche a mis en évidence la diversification croissante du paysage religieux cantonal et la vitalité qui le caractérise, en termes de pratiques religieuses, de pluralité linguistique et d’activités socioculturelles. Enfin, elle a approfondi la répartition des lieux de culte sur le territoire (documentée également au moyen d’une carte interactive), les dynamiques de visibilité et d’accès à des espaces, qui comptent souvent parmi les principaux défis auxquels sont confrontées les communautés recensées.
Les communautés religieuses musulmanes du Tessin s’inscrivent dans ce contexte dynamique et diversifié. S’appuyant sur les résultats de la recherche Re:Spiri, cet article décrit leur présence dans le canton, présente les lieux de culte musulmans et examine en détail les dynamiques d’accès à l’espace. En conclusion, il établit un parallèle entre l’invisibilité architecturale de ces lieux et la reconnaissance limitée des communautés musulmanes en tant que partie intégrante de la société tessinoise.
Une présence de plusieurs décennies dans le canton
En 2024, l’étude Re:Spiri a recensé la présence de neuf communautés musulmanes au Tessin, dont huit communautés sunnites et une communauté chiite, représentant 1,8 % des 503 communautés religieuses répertoriées. La création de communautés religieuses musulmanes reflète la diversification progressive du paysage religieux national et cantonal. Au Tessin, ce processus s’est déroulé en plusieurs étapes, d’abord au sein du christianisme, avec la fondation, à partir du XIXème siècle, de l’Église catholique chrétienne, des Églises évangéliques réformées et de l’Église anglicane. Au cours des premières décennies du XXème siècle, la diversification s’étend également en dehors du christianisme, avec la naissance de la Société théosophique (ésotérisme) et de la Communauté israélite de Lugano (judaïsme). Cependant, la diversité religieuse cantonale augmente considérablement à partir des années 1960, à la suite des différents mouvements migratoires et des effets de la mondialisation. Durant cette période apparaissent les premières communautés baha’ies, émergent des communautés bouddhistes et des nouveaux mouvements religieux, tandis que se multiplient les courants religieux chrétiens tels que le protestantisme évangélique, le millénarisme chrétien, le christianisme orthodoxe et le christianisme oriental.[1]
La recherche Re:Spiri montre que les premières communautés musulmanes du Tessin se sont officiellement constituées en associations[2] dans les années 1990. L’Association islamique turco-suisse, fondée en 1989, a commencé ses activités dans un lieu de culte dans les Grisons italiens, avant de s’installer définitivement au Tessin au début du XXIème siècle. En 1991, la Communauté islamique du canton du Tessin a été créée, suivie en 1999 par l’Association Islam sans frontières. Entre 2002 et 2009, quatre communautés musulmanes sunnites ont été créées : le Centre culturel turco-islamique de Lugano, le Centre culturel islamique albanais de Lugano, la Ligue des musulmans au Tessin et l’Association culturelle islamique du Mendrisiotto. La seule communauté chiite présente dans le canton est le Centre culturel Imam Ali du Tessin créé en 2004. Plus récemment, l’Association Džemat Tessin a été fondée.
Au Tessin, à partir des années 1990, on assiste donc à la création de structures associatives et à la constitution des premières communautés religieuses islamiques, signe d’une présence musulmane déjà bien établie dans le canton. En effet, se référant aux données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) concernant les appartenances religieuses individuelles, on constate que si en 1970, 0,1 % de la population résidant dans le canton se définissait comme musulmane, ce pourcentage a augmenté au cours des décennies suivantes, en particulier entre 1990 et 2000, passant de 0,5 % à 1,5 %. En 2010, la population musulmane du Tessin représentait environ 1,8 % du total, un chiffre qui s’est maintenu au cours des années suivantes. En 2023, le pourcentage de personnes de confession musulmane au Tessin est de 2,2 %, contre 6 % au niveau national. Selon ces données – qui se réfèrent à la population résidente permanente âgée de plus de 15 ans et qui nous renseignent peu sur la fréquence des pratiques religieuses et d’autres aspects de la religiosité – environ 6800 personnes se déclarant musulmanes vivront au Tessin en 2023 (OFS, 2025).
Des lieux de culte invisibles en périphérie urbaine
Parmi les principaux résultats de la cartographie Re:Spiri, l’analyse de la typologie des lieux de culte a permis d’interpréter le territoire à travers le prisme de l’(in)visibilité de ces espaces. Les lieux de culte des neuf communautés musulmanes présentes dans le canton sont concentrés dans les zones urbaines de Chiasso (trois communautés), Lugano (quatre communautés) et Bellinzone, où deux communautés partagent le même espace[3]. Cependant, malgré cette centralité apparente et la présence depuis plusieurs décennies de communautés musulmanes au Tessin, la recherche de lieux adaptés pour accueillir leur propre communauté reste un défi commun.
Les lieux de culte islamiques actuels sont difficilement reconnaissables en tant que tels et se trouvent souvent dans des zones industrielles et périphériques par rapport aux centres urbains. La réalité que l’allemand désigne par le terme assez évocateur de Hinterhof-Moschee – traduisible en français par « mosquée dans la cour intérieure » ou « mosquée cachée » – se retrouve également au Tessin, où l’ensemble des communautés musulmanes, à l’instar d’environ septante autres groupes religieux présents dans le canton, se réunissent dans des lieux réaménagés pour l’exercice des pratiques religieuses, initialement ni conçus ni construits à des fins religieuses. Il s’agit pour la plupart d’anciens locaux commerciaux ou d’appartements, souvent situés au rez-de-chaussée d’immeubles résidentiels. Aux yeux de la plupart des gens, ces lieux réaménagés pour la pratique religieuse restent invisibles.

Le Centre islamique de Bellinzone, inauguré le 27 septembre 2025, vu de l’extérieur (I).
Photo: Luan Afmataj, 2025

Le Centre islamique de Bellinzone, inauguré le 27 septembre 2025, vu de l’extérieur (II).
Photo: Luan Afmataj, 2025
L’accès à l’espace n’est pas seulement déterminé par des questions d’(in)visibilité, mais aussi par les modalités d’occupation des lieux, dont les communautés peuvent être propriétaires, locataires, sous-locataires ou bénéficiaires. Les résultats de Re:Spiri montrent que les communautés non chrétiennes et celles qui ont été fondées plus récemment au sein du christianisme sont généralement locataires ou bénéficient gratuitement du lieu de culte. En revanche, elles en sont plus rarement propriétaires que les communautés catholiques romaines, évangéliques réformées ou catholiques chrétiennes. Au Tessin, un seul lieu de culte islamique est en propriété. Cette précarité d’accès à l’espace concerne donc la majorité des communautés musulmanes, qui soulignent l’absence d’espaces adaptés à la pratique religieuse et le coût élevé des loyers parmi les principaux défis auxquels elles sont confrontées.
Entre invisibilité architecturale des lieux et invisibilité du rôle social des communautés
L’invisibilité architecturale des mosquées se reflète dans les dynamiques sociales, soulevant des questions d’inclusion et de cohésion. Au Tessin comme ailleurs en Suisse, la participation sociale des communautés musulmanes et leur diversité n’apparaissent que marginalement dans le débat public. Diverses études montrent que les personnes et les communautés musulmanes sont souvent présentées comme un problème à résoudre. Dans les discours politiques et médiatiques, elles apparaissent principalement en relation avec des thèmes tels que la radicalisation ou un supposé manque d’intégration (Trucco, Dehbi, Dziri, Schmid, 2025, 16-22). Une telle image, fondée sur des mécanismes d’exclusion et réductrice de la complexité, est remise en question par les données sociologiques présentées.
La recherche Re:Spiri met en effet en lumière de nombreux aspects de la diversité et du rôle social des communautés musulmanes. Par exemple, les langues utilisées pour la pratique religieuse sont l’italien – parlé dans toutes les communautés – ainsi que l’arabe, le turc, l’albanais, le bosniaque, le farsi et l’ourdou. La dimension de la diversité linguistique s’entremêle également avec les multiples activités socioculturelles menées. Parmi celles-ci, on peut citer les cours d’italien et de langue d’origine, les cours d’arabe et les moments de lecture du Coran. De nombreuses communautés proposent également des conférences, des cours d’enseignement religieux, des programmes périscolaires (comme un soutien aux devoirs), mais aussi des activités récréatives telles que des excursions et des journées jeu de société.
Les communautés célèbrent des fêtes traditionnelles et participent activement à des événements interculturels et interreligieux, ainsi qu’à des activités promues par des organismes publics, comme la Festa dei Popoli / La fête des Peuples de Locarno. Pendant le mois de Ramadan, des moments de partage pour la rupture du jeûne (iftar) sont organisés dans de grands espaces ouverts à la population. Ces initiatives mettent clairement en évidence la diversité des communautés musulmanes et leur contribution à la société tessinoise, aspects qui, à l’instar de l’invisibilité des lieux de culte, sont encore peu reconnus.

L’intérieur du nouveau Centre islamique de Bellinzone, partagé par deux associations musulmanes du Sopraceneri (I).
Photo: Luan Afmataj, 2025.
Perspectives d’approfondissement et de collaboration
Actives depuis des décennies au Tessin, les communautés musulmanes se caractérisent par leur diversité interne et leur dynamisme, visibles non seulement dans les pratiques religieuses, mais aussi dans la variété linguistique et les activités socioculturelles proposées. La présente contribution a offert un aperçu des communautés sur la base de données quantitatives présentées dans une recherche centrale pour le Tessin[4]. Les éléments qui en ressortent suggèrent une pluralité analogue à celle d’autres cantons, qui mériterait d’être analysée plus en profondeur à l’aide de données qualitatives permettant d’explorer plus en détail la diversité des parcours individuels et d’autres spécificités des communautés musulmanes du Tessin. Bien qu’elles participent activement et contribuent de manière significative à la cohésion sociale, les communautés musulmanes restent largement invisibles sur le plan architectural et peu reconnues sur le plan social. Dans ce contexte, il est nécessaire que les institutions mènent une réflexion critique sur la voie à suivre pour surmonter les obstacles qui limitent une participation équitable et réduisent la visibilité de la contribution des communautés musulmanes à la société tessinoise. À cette fin, il est essentiel de promouvoir des liens de confiance et de renforcer la collaboration avec les associations musulmanes, afin de répondre aux besoins exprimés, de dialoguer à la recherche de solutions communes et de relever ensemble les défis futurs.
[1] Cf. Moretti, F., Roveri, T. (dir. Farahmand, M., Piraud, M.) (2024). Pour plus d’informations sur les traditions et les courants religieux présents au Tessin, voir le glossaire élaboré par le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), disponible sur le site internet Geo-religions.ch : https://geo-religions.ch/panorama-de-lensemble-des-communautes-religieuses-et-spirituelles/ consulté le 22.09.2025.
[2] Toutes les communautés musulmanes actuellement actives au Tessin sont organisées sous forme d’associations et soumises au droit privé. Dans le canton, seules l’Église catholique romaine et l’Église évangélique réformée sont reconnues comme corporations de droit public, conformément à l’article 24 de la Constitution cantonale. Le deuxième alinéa du même article n’exclut pas la possibilité d’attribuer la « personnalité de droit public à d’autres communautés religieuses » ; toutefois, la législation cantonale ne fournit pas d’indications précises sur la manière dont cette procédure doit être appliquée dans la pratique (Moretti, Roveri, 2024 : 36-39).
[3] Voir la carte interactive de la diversité religieuse et spirituelle du canton du Tessin, accessible sur le site internet Geo-religions.ch, réalisé par le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC). https://geo-religions.ch/it/, consulté le 26.05.2025.
[4] Cf. Moretti, F., Roveri, T. (dir. Farahmand, M., Piraud, M.) (2024). Re:Spiri. Cartographie de la diversité religieuse et spirituelle du canton du Tessin. Annuaire d’histoire religieuse de la Suisse italienne III, Faculté de théologie de Lugano.
Bibliographie
Littérature
- Moretti, F., Roveri, T. (dir. Farahmand, M., Piraud, M.) (2024). Re:Spiri. Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino. Annuario di Storia Religiosa della Svizzera Italiana III, Facoltà di Teologia di Lugano.
- Trucco, N., Dehbi, A., Dziri, A., Schmid, H. (2025).. Il razzismo antimusulmano in Svizzera: studio di riferimento. SZIG/CSIS-Studies 12. Friborgo: Centro Svizzero Islam e Società.
Liens
- Camplani, Barbara (05.04.2025). Islam invisibile. Le comunità musulmane nel contesto svizzero, RSI Moby Dick.
- Centro intercantonale di informazione sulle credenze (CIC). Sito internet Geo-religions.ch, comprendente la Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino.
- Conferenza “Re:Spiri. Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino” del 27 febbraio 2025, Repubblica e Cantone Ticino.
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (stato 1° gennaio 2023).
- Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 3 marzo 2024).
- Dipartimento delle istituzioni (28.02.2025): “Successo della presentazione di Re:Spiri – Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino”. Comunicato stampa.
- Ufficio federale di statistica (UST). Religioni.
Pour aller plus loin
Littérature
- Afmataj, L. (anno accademico 2024-2025). Il ruolo delle associazioni islamiche in Svizzera. Le differenze religiose secondo la provenienza dei musulmani nel Canton Ticino. Tesi di Dottorato in Scienze Religiose. Facoltà di Teologia di Lugano.
- Trisconi, Michela. (2007). Repertorio delle religioni. Panorama religioso e spirituale del Cantone Ticino. Bellinzona: Dipartimento delle istituzioni