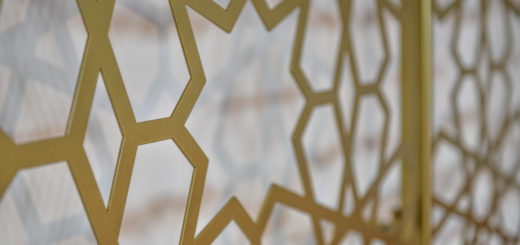En Suisse, des femmes salafistes en quête d’une vie qui plaise à Dieu

Dans le cadre de l’étude qualitative sur le salafisme en Suisse alémanique que nous avons menée de 2019 à 2022 au Centre de recherche sur la religion (« Zentrum Religionsforschung ») de l’Université de Lucerne, nous estimions qu’en Suisse, quelques centaines à un millier d’hommes et de femmes environ se reconnaissaient dans ce courant de l’islam. Ce groupe de taille modeste se caractérise par son hétérogénéité et son dynamisme [voir https://islamandsociety.ch/fr/salafisme// ; Endres et al., 2023]. Dans leur grande majorité, les femmes qui font partie d’un groupe salafiste suisse suivent l’une des deux tendances suivantes : soit elles se concentrent sur l’acquisition de savoirs et sur la pratique religieuse personnelle, en s’organisant autour de diplômé∙e∙s d’universités d’Arabie saoudite, et sans poursuivre de visée politique ; soit elles s’associent à un groupe qui s’affirme par un activisme politique plus marqué autour du Conseil Central Islamique Suisse (CCIS). Elles se rencontrent de temps à autres dans les mosquées ou des logements de particuliers et partagent des excursions. Au fil des dernières années toutefois, leurs activités se sont de plus en plus déplacées dans le monde virtuel, espace qu’elles jugent plus compatible avec leurs responsabilités familiales. Les groupes de tchats leur permettent d’entretenir des contacts et les offres de formation islamique en ligne sont maintenant bien établies. Les échanges qu’elles ont entre elles, les conférences et les cycles de cours qui sont réservées aux femmes portent souvent sur les représentations des rôles de genre, du mariage et de la famille ainsi que sur la volonté de suivre une formation islamique. Le présent article pose des questions clés et décrit les moments de friction qui apparaissent dans les groupes que ces femmes forment, mais aussi entre elles et leur contexte social.
Visibilité et rôles de genre
En raison de représentations différentes de ce que sont la dawa (« invitation à embrasser l’islam », prédication) et l’idéal du comportement féminin, les femmes qui s’inscrivent dans la première tendance n’apparaissent guère dans l’espace public, alors que les activistes du CCIS recherchent la publicité des médias. En invoquant les rôles attribués aux deux sexes, certaines femmes rejettent la dawa féminine publique tel qu’elle s’incarne notamment dans la distribution du Coran dans les zones piétonnes, dans la mise en ligne de vidéos et de discussions entre femmes diffusés sur les médias sociaux : pour elles, les femmes devraient éviter de se faire remarquer dans la sphère publique et ne pas élever la voix. Elles seraient aussi protégées, en tant que « sexe faible », des réactions racistes ou islamophobes que pourraient susciter de telles activités.
Ces deux tendances du salafisme partagent de manière générale une compréhension traditionnelle des rôles de genre, qui voit les femmes s’occuper de préférence du foyer en assumant la responsabilité du ménage et de l’éducation des enfants, tandis qu’il revient à leur époux d’assurer l’entretien de la famille et de représenter celle-ci à l’extérieur. Dans leur majorité, sauf si celle-ci s’impose à la famille pour des raisons financières, elles rejettent l’idée d’une activité lucrative. Dans des conférences ou sous forme de recommandations (des « exhortations »), le salafisme traite très souvent de leur comportement en tant que bonnes musulmanes, bonnes épouses et bonnes mères. La soumission à leur mari, le rôle de modèle qu’elles sont appelées à jouer pour que leurs enfants deviennent de pieux musulmans et musulmanes et le fait d’incarner vis-à-vis de l’extérieur la compréhension de l’islam qu’elles représentent (par leur habillement et par leur interaction avec musulmans et non-musulmans) constituent des éléments centraux à cet égard. Si elles ont l’impression que leurs époux ne satisfont pas suffisamment à leurs attentes d’une vie dévouée à l’islam, les partisanes de ces rôles de genre ne les suivent pas aveuglément et sans contestation. Il n’est pas rare que des divergences entre mari et femme sur la façon dont l’islam devrait être pratiqué débouchent sur un divorce.
Trouver le juste partenaire
Pour prévenir une séparation, les salafistes en Suisse n’hésitent pas à préciser d’emblée leurs attentes par rapport aux rôles dans le mariage, ainsi que l’importance que revêt pour eux l’islam. Pour faire connaître les prétendants au mariage, des portraits ou des profils personnels sont échangés dans des groupes de tchats jusqu’à l’étranger. En plus de renseigner sur la personne (sa profession, son âge et sa taille par exemple), sur ses intérêts et ses loisirs ainsi que sur ses caractéristiques (ses points forts et ses points faibles), ces présentations se concentrent sur les souhaits et les exigences qui concernent la pratique religieuse : depuis quand est-il pratiquant ou est-elle pratiquante ? A-t-il ou a-t-elle des connaissances de la langue arabe et s’intéresse-t-il ou s’intéresse-t-elle à acquérir des connaissances de l’islam (cours, exposés, etc.) ? Porte-t-il la barbe, porte-t-elle le hidjab, le niqab ?
Pour beaucoup, la question d’un mariage polygame se pose également. Le CCIS a traité ce sujet en 2020 et 2021 des mois durant par l’intermédiaire de ses canaux habituels, mais d’autres femmes s’en emparent également régulièrement. Décrite comme par le CCIS comme une « norme islamique », la polygamie est globalement reconnue par les femmes salafistes comme un modèle de mariage islamique légitime, dans lequel elles perçoivent divers avantages. En pratique toutefois, les salafistes qui vivent dans un mariage polygame sont très peu nombreux en Suisse (en Suisse un mariage qui inclut plus de deux conjoint n’est pas reconnu, les personnes ne seront pas considérées comme légalement mariées) Dans les faits, un mariage polygame fait aussi naître des frictions et des conflits (v. également Menzfeld 2023a; Menzfeld 2023b).
Un souhait d’appartenance et d’acceptation
Du fait que de nombreuses salafistes vivent en retrait et qu’elles expérimentent plus d’actes négatifs dans l’espace public que d’autres musulmanes, les échanges et le soutien d’autres femmes qui partagent et défendent leur compréhension de l’islam est d’autant plus important. Toutefois, tout comme Anabel Inge, spécialiste britannique des religions, l’a décrit pour des musulmanes en Angleterre (Inge 2017), on peut affirmer que souvent, il n’est pas facile d’être acceptée dans des groupes de femmes que ce soit en Allemagne (Dickmann-Kacskovics 2024) ou en Suisse. Fondamentalement ouverts à accueillir de nouvelles femmes, ces groupes sont aussi parfois très soucieux de corriger leur apparence et leur comportement, par exemple en leur signalant que porter un turban en tant que voile n’est pas conforme à l’islam. Autrement dit, si ces groupes offrent aux femmes une acceptation et une validation, ils sont aussi souvent le lieu d’un fort contrôle social, où les comportements déviants sont contestés.
Comment se couvrir ?
Chez les femmes, l’adhésion à l’islam, ou ultérieurement au salafisme, se manifeste d’abord d’une manière visible, par une modification du style vestimentaire. L’habit se fait plus ample et plus long, les femmes décident de couvrir leur chevelure ou de porter un niqab. On trouve parmi les salafistes diverses opinions sur ce que doit être une « façon correcte de se couvrir », ce qui n’est pas sans susciter des discussions dans les groupes. Beaucoup de femmes considèrent que le khimar est la tenue la plus adaptée pour les femmes et elles indiquent qu’il est le vêtement dans lequel elles se sentent le plus à l’aise. Elles sont une minorité à opter pour une dissimulation complète en couvrant leur visage d’un voile – ou d’un masque hygiénique en raison de l’interdiction légale de se dissimuler le visage – et, le cas échéant de porter des gants. Nora Illi, porte-parole des affaires féminines du CCIS, femme convertie, décédée en Suisse en 2020, aura été la défenseuse la plus connue du port du niqab. Après que l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » a été acceptée en mars 2021, depuis 2025, le visage doit être découvert dans l’espace public partout en Suisse. Face à cette évolution notamment, les femmes qui souhaitent dissimuler leur visage en public tendent à sortir plus rarement de chez elle et à envisager de faire leur hijra (émigration) dans un pays à majorité musulmane. Au cours des dernières années, certaines ont déjà franchi ce cap ; elles souhaitent aussi que l’émigration dans une société dans laquelle l’islam est plus visible et où il est généralement perçu de manière plus positive facilite l’éducation islamique de leur enfants. Pour elles, offrir à leurs enfants une éducation islamique en Suisse est l’un des enjeux les plus importants mais aussi l’un des défis les plus grands auxquels elles sont confrontées. Elles jugent qu’en Suisse, les jeunes gens sont soumis à trop de tentations et distractions qui les écartent d’un mode de vie conforme à l’islam, et que l’approche de la sexualité et l’importance accordée à la pratique religieuse quotidienne leur sont trop contraires.
Acquisition de connaissances sur l’islam
Pour s’acquitter de la manière la plus complète possible de l’éducation islamique de leurs enfants et suivre leur idéal d’entamer ou de poursuivre leur propre formation religieuse, elles sont nombreuses à considérer qu’approfondir en permanence leurs connaissances de l’islam est essentiel, que ce soit en étudiant les sciences islamiques, en participant à des cours ou en suivant des conférences. L’apprentissage de la langue arabe est leur souhait premier, et fondamental, qui vise à leur offrir un accès plus direct aux sources islamiques. Nombre d’entre elles expliquent aussi suivre des études islamiques : tafsir (exégèse du coran), hadiths (acte ou parole du prophète Mohammed, rapporté par une chaîne de transmetteurs), sira (biographie du prophète) et usul al-fiqh (principes qui dictent la jurisprudence islamique). Ces cours sont en général donnés en opérant une séparation ses sexes, y compris en ligne : dans les cours destinés aux hommes et aux femmes, les femmes posent leurs questions à l’enseignant non pas par oral, mais seulement par écrit sous forme de tchat et elles n’enclenchent pas leur caméra. Sur diverses plateformes islamiques de formation, en Allemagne notamment, de nombreux cours sont proposés par des enseignantes à un public exclusivement féminin, pour lequel de telles mesures ne sont pas nécessaires. En Suisse alémanique, les femmes suivent notamment sur le site islamstudium.de les cours de Maida Hamzic, diplômée en sciences islamiques de l’Université de la princesse Nora bint Abdul Rahman (PNU) de Riyad en Arabie saoudite. D’autres font état des cours donnés par Atia Chohan qu’elles suivent sur le site tayyibah.net. Certaines transmettent l’enseignement qu’elles reçoivent dans ces cours à leurs sœurs, soit à la mosquée soit dans les groupes de chat dans lesquels elles évoluent. Particulièrement appréciés, les cours donnés par Nicola Zaknoun-Streule, qui a obtenu de nombreux diplômes dans des universités d’Arabie saoudite, sont une constante depuis plusieurs années : la Suissesse enseigne durant ses séjours en Suisse ou depuis son domicile d’Arabie saoudite par WhatsApp, en couvrant des thèmes qui vont de la lecture et de l’explication des ouvrages de l’érudit Ibn Uthaymin (mort en 2001), très répandus dans le monde salafiste, à la hidjama (saignée par ventouses) en passant par la toilette des morts.
Conclusion
En Suisse, les femmes qui font partie du salafisme sont très peu nombreuses. Sur des questions d’enseignement ou de pratique de la foi, cette forme particulière de l’islam sunnite témoigne d’une capacité limitée, voire inexistante, de compromis vis-à-vis d’autres formes de compréhension de l’islam ou face à des aspects de la société suisse qu’elle considère comme n’étant pas conformes à l’islam. Dans leur vie quotidienne, ces femmes connaissent donc souvent des questions et des moments de friction, qu’elles cherchent à résoudre ou apaiser par des échanges avec d’autres qui partagent leur vision et par une étude approfondie de l’islam, et en partie aussi par un activisme social et politique. Elles visent ainsi une vie qui plaise à Dieu, et si elles ont des doutes quant à la possibilité d’y parvenir en Suisse, elles envisagent d’émigrer dans un pays islamique.
Bibliographie
Littérature
Inge, A. (2017). The making of a Salafi Muslim woman: paths to conversion. Oxford University Press.