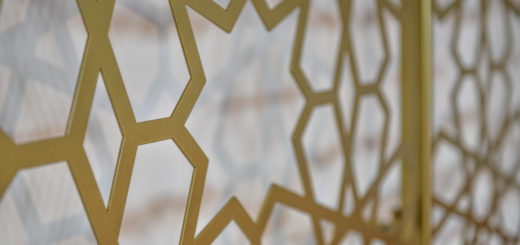Désengagement et transformation religieuse : l’après-condamnation pour terrorisme

Toute personne condamnée pour avoir soutenu une organisation à caractère islamiste et qualifiée de terroriste a en général au moins un certain lien avec l’islam, qu’il s’agisse d’une appartenance religieuse ou d’une attitude politique et idéologique. Depuis le début du millénaire, 38 personnes adultes (30 hommes, 8 femmes) ont été condamnées en Suisse par le Tribunal pénal fédéral pour leur soutien ou leur participation à une organisation terroriste (auxquelles s’ajoute un nombre inconnu de condamnations par ordonnance pénale et une douzaine de condamnations par les tribunaux des mineurs). Dans tous les cas, il s’agissait d’actes en faveur de groupes djihadistes comme « Al-Qaïda » ou le prétendu « État islamique » (EI). Alors que la perception dominante associe le terrorisme islamiste à la religion musulmane, nous savons en réalité très peu de choses sur le rapport à la religion des personnes condamnées.
Le religieux indissociable du politique
Dans les débats sociaux, politiques, académiques et juridiques, la question du rôle de la religion ou de la religiosité dans une éventuelle radicalisation est souvent évoquée. Comment la personne en est-elle arrivée là ? Quand et comment une personne s’est-elle radicalisée ? Était-elle même religieuse ? Ces questionnements sont en partie dû au fait que les auteurs d’attentats justifient souvent eux-mêmes leurs actes de violence dans des termes religieux. L’hypothèse selon laquelle la religion serait un facteur central – voire que plus de religiosité mène inévitablement à plus de radicalité et donc plus de danger – demeure tenace.
Pourtant, ces dernières années, la recherche a fait des découvertes passionnantes sur ces questions. Il en ressort clairement que dans le domaine de la radicalisation islamiste, le religieux n’est pas séparable du politique.
Le sentiment d’appartenance religieuse peut fournir une identité collective et favoriser ainsi l’identification à des situations dans lesquelles les musulman·e·s sont perçu·e·s opprimé·e·s. La représentation religieuse du monde peut également conduire à ce que les conflits soient lus comme des guerres de religion, voire des attaques ciblées contre les musulman·e·s. La religion confère en outre à l’engagement, souvent risqué, un caractère sacré, une certaine grandiosité et des arguments doctrinaux religieux peuvent servir à convaincre les gens et à les pousser à agir.
Sécuritisation de la vie et de l’activisme musulmans après le 11 septembre
Parallèlement, dans le cadre de ladite « lutte contre le terrorisme », il existe des schémas de pensée orientalistes qui peuvent conduire à une survalorisation du rôle de la religion et de la religiosité. Cela s’explique notamment par le fait que les études sur le terrorisme ont tendance à individualiser et à dépolitiser le phénomène, le terrorisme étant un sujet politiquement très sensible : ainsi, les facteurs géopolitiques et sociopolitiques de radicalisation ont tendance à être occultés et, réciproquement, les composantes religieuses et idéologiques à être surestimées.
Dans ce contexte, on assiste à une sécuritisation de la vie musulmane dans le contexte post-9/11 qui a pour conséquence que certaines expressions religieuses ou conversions à l’islam sont considérées comme des signes avant-coureurs de la violence extrémiste et deviennent ainsi l’objet d’un scepticisme des autorités. Lors des interrogatoires ou au tribunal, il est parfois demandé aux accusés quelle image ils ont des femmes, s’ils serrent la main des femmes, quels sont les cinq piliers de l’islam, quelle est leur position sur la shari’a ou s’ils sont favorables au jihad. Les termes arabes et les concepts islamiques sont ici interprétés de manière réductionniste et eurocentrique : la shari’a est uniquement associée aux châtiments corporels ; le jihad au meurtre des infidèles, la hijra au voyage sur le territoire d’une organisation terroriste.
En outre, le concept de taqiya s’est également établi dans les milieux de la sécurité. Ce concept, qui, selon certaines interprétations doctrinales, permet à des groupes persécutés de dissimuler leur propre foi pour se protéger de la coercition ou d’un danger de mort, sert à légitimer la méfiance institutionnelle envers les personnes accusées. Toute prise de distance par rapport à l’organisation interdite, à ses idées ou à la religion en général n’est pas considérée comme une évolution positive, mais est regardée avec suspicion, car la personne pourrait être en train de pratiquer la taqiya.
Enfin, la « lutte contre le terrorisme » dans les contextes occidentaux ne se fait pas en vase clos, mais dans un contexte sociopolitique marqué, du moins en partie, par un racisme anti-musulman. Dans l’imaginaire collectif, le terrorisme est perçu comme étant principalement islamiste ; les musulman·e·s et l’islam sont davantage problématisés dans les médias en relation avec la radicalisation et le terrorisme. En raison de cet amalgame entre le comportement délinquant et la religion ou la religiosité, la confrontation avec le pouvoir étatique impose généralement une réflexion sur sa propre religion ou religiosité.
Entre relativisation, intensification et continuité
Mais quel est le résultat de ce débat ? Nous en savons encore très peu à ce sujet. Que se passe-t-il par exemple avec les personnes qui se détournent des infractions à caractère terroriste ? Celles qui sont condamnées et qui n’apparaissent plus sur le plan pénal ? Ce « désengagement », comme on l’appelle dans le jargon, signifie-t-il nécessairement un abandon de la religion ? Quels changements ces personnes opèrent-elles dans leur religiosité – et qu’est-ce qui demeure inchangé ?
Dans mes recherches sur les personnes condamnées pour des infractions liées au terrorisme, je constate une grande hétérogénéité à cet égard et pourtant trois tendances se dégagent :
- Relativisation : l’engagement politico-religieux, le plus souvent en faveur d’un groupe interdit, diminue ou la personne s’éloigne complètement de l’islam. Cela peut aussi conduire à une attitude hostile à l’islam.
- Intensification : il en résulte une politisation accrue et/ou un sentiment d’appartenance plus fort, voire une pratique religieuse plus intense. Dans certains cas, cela peut produire une nouvelle radicalisation, et cas échéant la commission de nouvelles infractions pénales.
- Continuité : l’engagement politico-religieux est maintenu sans qu’il y ait de comportement délictueux ; ou l’engagement politico-religieux qui n’existait pas à la base reste absent (apolitique et areligieux).
Voici quelques exemples anonymisés tirés de la pratique qui servent à illustrer les trois tendances, sachant que celles-ci peuvent bien évidemment se chevaucher :
Islam = « État Islamique »
Luca (23 ans) et Max (30 ans) se sont tous deux convertis à l’islam en lien avec leurs sympathies pour l’EI. Une fois arrêtés, pendant leur détention et après leur sortie de prison, ils ont d’abord pris leurs distances avec le groupe, puis rapidement avec la religion dans son ensemble. Tous deux se sont réintégrés dans leur environnement familial non musulman et entretiennent des relations amoureuses avec des femmes non musulmanes. Le seul islam qu’ils connaissaient était l’islam intransigeant tel qu’il était interprété par l’EI et, de leur point de vue – ce qui est compréhensible – celui-ci n’est pas compatible avec un projet de vie conforme aux règles de la vie en Suisse.
« La shari’a entre mes quatre murs »
Matteo (38 ans) a sympathisé avec l’EI et a été condamné pour avoir soutenu l’organisation. Il s’est certes détourné de celle-ci, mais il continue à adhérer à une interprétation très stricte de l’islam (qui, selon lui, n’est pas « stricte », mais la seule « correcte »). Il limite toutefois cette interprétation à sa sphère privée : « j’essaie de vivre la shari’a entre mes quatre murs, pour ainsi dire ». En même temps, son désengagement est lié à une dépolitisation de sa pratique religieuse : Il évite d’aborder les conflits qui concernent les personnes musulmanes, comme le conflit au Proche-Orient, car cela le « radicaliserait ». Dans son cas, on observe à la fois une continuité religieuse et une relativisation politique.
« Je suis sorti du procès en tant que musulman plus croyant »
Redouan, 33 ans, a été condamné pour avoir fait de la propagande pour le groupe « Al-Qaïda » – une accusation qu’il a toujours niée. Il a ressenti le procès comme injuste, ce qui l’a « radicalisé politiquement », comme il le dit lui-même, tout en faisant de lui un « musulman plus croyant ». La religion l’a aidé à surmonter la période d’accusation et la condamnation, elle l’a aussi conforté dans sa foi. Même lorsqu’il est confronté au conflit du Proche-Orient, contre lequel il s’engage politiquement, il s’accroche à sa foi et à l’espoir que Dieu apportera une solution. Chez lui, la religion fait office de mécanisme d’adaptation, du moins en partie. On observe donc chez Redouan une intensification à la fois religieuse et politique.
« J’ai commencé à détester tout ce qui avait trait à l’islam »
Sami (41 ans) a été condamné pour sa participation à l’EI. Lui-même a toujours nié toute sympathie pour l’EI. Lui qui est arrivé en Suisse en tant que demandeur d’asile ne s’est jamais considéré comme religieux et se décrit même comme un analphabète religieux : En prison, il a demandé à un imam de lui écrire la fatiha, la première sourate du Coran, afin de la réciter, dans l’espoir de mieux supporter l’isolement. Après sa libération, il ne s’est pas rapproché de la religion, bien au contraire. Il a commencé à rejeter tout ce qui avait un rapport avec l’islam et à éviter tout contact avec des personnes perçues comme arabes ou musulmanes, car il associait sa condamnation à l’islam et craignait d’avoir à nouveau des problèmes avec les autorités : « Je me suis mis à détester tout ce qui avait un rapport avec l’islam ou les Arabes. »
Ces brefs exemples illustrent tout d’abord l’hétérogénéité qui semble caractériser les changements d’appartenance et de pratique religieuse dans le contexte d’une condamnation pour une infraction terroriste. Une condamnation et un processus de désengagement ou de désistance peuvent s’accompagner aussi bien d’une relativisation, voire d’un abandon de la religion, que d’une intensification de la religiosité ou même d’une forme de radicalisation politico-religieuse.
Ces exemples montrent en outre que le changement de religiosité à la suite d’une confrontation avec le pouvoir étatique semble être lié à la place et au rôle de la religion chez les personnes interrogées avant cette confrontation. Si le religieux n’avait qu’un but instrumental ou s’il était exclusivement lié à un groupe particulier, le désengagement semble avoir tendance à aller de pair avec une distanciation de l’islam. Mais là où il y avait une compréhension plus large de l’islam, on peut constater une modification de la religiosité, par exemple une privatisation ou une dépolitisation, afin de pouvoir mener une vie conforme aux normes légales établies.
Le piège de la taqiya
Finalement, j’ai également observé que dans le contexte de la « lutte contre le terrorisme », il peut s’avérer utile pour les personnes concernées de se détourner complètement de l’islam. Celui qui se détourne de l’islam ne soutiendra pas de sitôt un groupe interdit d’obédience islamiste, pense-t-on, parfois à juste titre. Cette possibilité n’est toutefois pas accessible à tous de la même manière et dépend des caractéristiques attribuées à une personne : Max et Luca, tous deux des hommes blancs de nationalité suisse, ont effectivement pu réduire le scepticisme des autorités en prenant leurs distances et commencer à reconstruire leurs vies. Mais Sami, sans autorisation de séjour garantie en Suisse et qui, en raison de son apparence et de son nom est racisé et perçu comme arabo-musulman, reste suspect – indépendamment de son positionnement athée. Il peine à construire un projet post-condamnation stable. Si Max et Luca ont également dû lutter au début contre le piège de la taqiya, leur blanchité semble avoir accéléré leur sortie de ce piège. Pour Sami, en revanche, c’est beaucoup plus difficile. La qualification de sa personne comme menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse par les autorités, qui perdure depuis des années, l’enfermant dans un suspens permanent, en témoigne.
Pour aller plus loin
Littérature
- Ajil, A. (2025). Pain & power: what the pains of counterterrorism tell us about the workings of counter-terror power. Critical Studies on Terrorism, 1-26.
- Ajil, A. (2023). Politico-ideological mobilisation and violence in the Arab World: All in (p. 288). Taylor & Francis.
- Ajil, A. (2023). Decolonizing terrorism: Racist pre-crime, cheap orientalism, and the Taqiya* trap. In The Routledge international handbook on decolonizing justice (pp. 202-212). Routledge.
- Dawson, L. L., & Amarasingam, A. (2017). Talking to Foreign Fighters: Insights into the Motivations for Hijrah to Syria and Iraq. Studies in Conflict & Terrorism, 40(3), 191–210. https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1274216
- Dutta, S., Abbas, T., & Bergh, S. I. (Eds.). (2025). Global counter-terrorism. Manchester, England: Manchester University Press. Retrieved Apr 8, 2025.
- Mohamedou, M. M. O. (2017). A theory of ISIS: Political violence and the transformation of the global order. Pluto Press.
- Saal, J., & Liedhegener, A. (2024, August). Religion und politische Gewalt. Neue empirische Erkenntnisse zu religiöser Radikalisierung und Terrorismus. In Religion–Wirtschaft–Politik (pp. 429-464). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Sharma, S., & Nijjar, J. (2018). The racialized surveillant assemblage: Islam and the fear of terrorism. Popular Communication, 16(1), 72–85.
- Trucco, N., Dehbi, A., Dziri, A., & Schmid, H. (2025). Racisme anti-musulman en Suisse : Étude de référence (SZIG/CSIS-Studies 12).